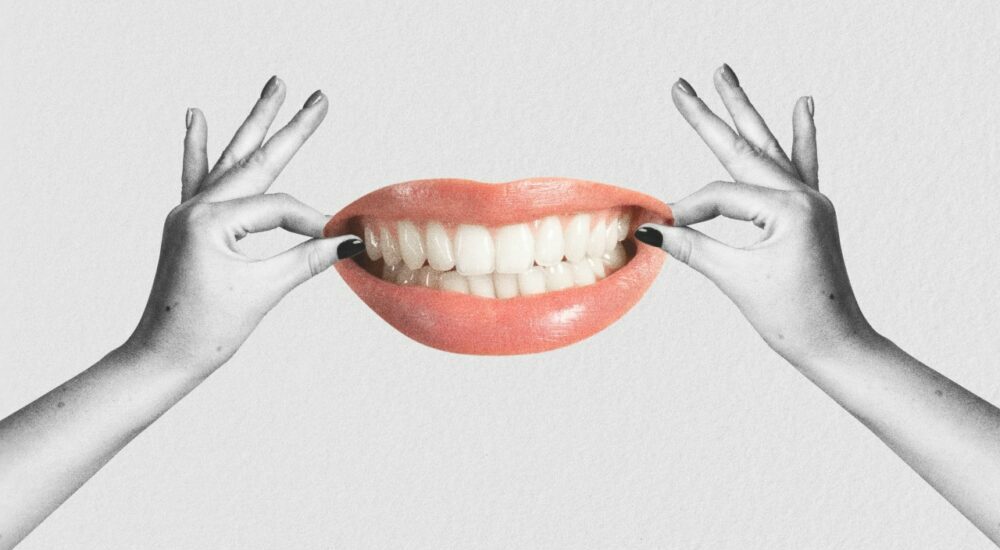Cas d’un implant unitaire en zone : comment planifier son geste ?
Le transfert précis en chirurgie de l’axe planifié et le forage guidé permettent d’optimiser le geste pour un résultat esthétique optimal.

Traitement implantaire : le transfert précis en chirurgie de l’axe planifié et le forage guidé optimise le geste pour un résultat optimal.
Une patiente de 68 ans présente une atteinte carieuse profonde de la canine supérieure gauche relevant de l’extraction et d’un traitement implantaire; (Fig. 1a, b, c).
...Ce contenu est réservé aux utilisateurs inscrits sur le site dentaire365.fr
Déjà abonné ? Connectez-vous