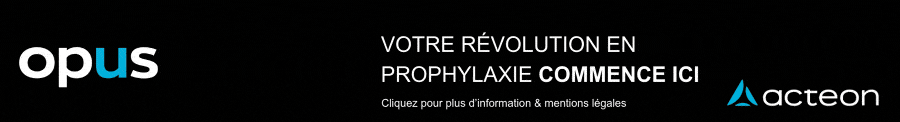L'hygiène bucco-dentaire, nerf d'une guerre qui dure...
Pour favoriser l'adoption de comportements d'hygiène adaptés au sein de la population, un changement de paradigme concernant la prévention primaire est sans doute requis

Se brosser les dents deux minutes après les repas en utilisant une brosse à dents souple, du dentifrice fluoré et du fil dentaire. Ces grandes règles d’hygiène dentaire sont pour la plupart également connues de la population. Excepté peut-être dans certains publics atteints de troubles cognitifs ou neurodéveloppementaux, « les individus qui ne se brossent jamais les dents sont vraiment très rares », confirme le Dr Jérémy Bazart, chirurgien-dentiste référent du centre de santé mobile de Seine-Saint Denis et membre du bureau de l’Association française des acteurs de la santé publique bucco-dentaire (ASPBD).
Cependant, les maladies bucco-dentaires associées à une hygiène dentaire inadaptée comme les caries ou les troubles parodontaux sont loin d’être éradiqués. Ainsi, en France, 32 % des adultes présenteraient une parodontite sévère. Tel est du moins le chiffre établi en 2024 au sein de la cohorte Constances. Dans le même esprit, selon le ministère de la Santé, trois quarts de la population adulte serait concernée par les caries dentaires. Dans ce contexte, il apparaît urgent d’améliorer et de renforcer l’application des gestes prophylactiques d’hygiène bucco-dentaire.
Informer sur l’impact de l’hygiène orale sur la santé générale
Pour ce faire, une meilleure information du public est sans doute requise. À commencer par l’impact de l’hygiène bucco-dentaire sur la santé systémique. « Les patients ne sont pas au courant des conséquences pour leur santé générale, alors même que certaines sont bien établies », constate le Dr Margaux Dubois, chirurgien-dentiste chef de clinique universitaire au CHU de Nice et chercheuse au laboratoire Microralis – centré sur le microbiote oral et l’immunité. Ont en effet été démontrés des liens entre dysbiose et diabète, athérosclérose, complications de grossesse (notamment pré-éclampsie). Et de plus en plus de données suggèrent un surrisque de maladie neurodégénérative comme Parkinson ou Alzheimer, ou de rhumatisme inflammatoire chronique chez les patients atteints de maladie parodontale.
Autre axe d’informations à mieux délivrer : les liens entre alimentation et hygiène bucco-dentaire. « Tout le monde ou presque sait que le sucre favorise à termes les lésions carieuses », reconnaît le Dr Dubois. Cependant, l’influence négative d’autres types d’aliments, notamment acides, sur la santé bucco-dentaire, reste moins connue. « Le jus de citron, les sodas comme le coca peuvent causer des dissolutions de l’émail et des tissus dentaires irréversibles », rappelle la praticienne. Certaines catégories de la population – parfois inattendues – restent particulièrement exposées à une alimentation très cariogènes. Par exemple, « les sportifs ont des prises alimentaires augmentées d’aliments très sucrés et très collants et de boissons énergétiques acides », note le Dr Dubois, qui consacre des recherches à ce sujet.
Un interrogatoire plus fin
Enfin, les patients rapportent des difficultés à se repérer au sein d’une offre de produits d’hygiène pléthorique. « Pour nombre de produits dentaires, c’est le marketing qui semble primer : à part l’ajout de fluor, les produits ajoutés aux dentifrices ne semblent pas avoir de bénéfice évident » tandis que les pâtes abrasives, les dentifrices au charbon noir, les dentifrices bio et les coffres DIY se multiplient, analyse l’association de patients La Dent bleue. Celle-ci dénonce une disparition de la frontière entre « patients et consommateurs ».
Mais reste à savoir comment favoriser la bonne information des patients. Evidemment, cela passe notamment par l’intervention des chirurgiens-dentistes. « C’est le médecin qui (…) doit indiquer à chaque patient les moyens les mieux adaptés à sa situation personnelle », estime La Dent bleue.
Cependant, il est difficile en pratique de favoriser réellement les changements de comportement lors d’une consultation. Tout d’abord du fait que l’interrogatoire préalable – qui permettrait d’adapter le propos – se révèle souvent insuffisant. « La plupart des gens disent se brosser les dents le matin, mais les dentistes demandent rarement quand le matin, or nombre d’individus notamment issus de la population immigrée post coloniale pourraient se brosser les dents au réveil, et non après le petit-déjeuner », observe le Dr Bazart.
L’entretien motivationnel trop peu enseigné
Les informations et conseils doivent être dispensés sur un mode adapté, respectueux de l’autonomie. « Il faut tenter de ne pas être culpabilisant, redonner de l’estime de soi », suggère le Dr Bazart. Le faible niveau de littéracie en santé de certains publics complique la donne. Or les techniques d’entretien motivationnel, qui constituent une aide précieuse, restent trop peu enseignées. Et le fossé socio-économique et culturel entre de praticiens et patients peut parfois compliquer la communication. « Si je m’adresse, moi, homme blanc, hétérosexuel, en cravate, à une femme immigrée d’Afrique subsaharienne séropositive, je suis inaudible : il faut parfois trouver un relai plus proche des patients, par exemple au sein d’une association », raconte le Dr Bazart.
En outre, la démographie dentaire toujours insuffisante dans certaines régions n’aide pas les praticiens à octroyer davantage de temps aux conseils d’hygiène. « Tous les dentistes ne prennent (déjà) pas le temps de conseiller leurs patients », juge la Dent bleue. Et la possibilité de recourir à des hygiénistes dentaires tarde à se concrétiser en France. « Plus généralement, l’ambiance actuelle de désertification médicale, d’apparition de centres dentaires low cost, etc. ne rend pas optimiste », déplore le Dr Bazart.
Pour une meilleure santé publique bucco-dentaire
De surcroît, pour favoriser l’adoption de comportements d’hygiène adaptés au sein de la population, un changement de paradigme plus profond concernant la prévention primaire est sans doute requis. Car « l’apparition de caries ne dépend pas que de la présence de sucre, de bactéries, de facteurs temporels ou liés à l’hôte, mais aussi des inégalités sociales de santé », souligne le Dr Bazart. Des inégalités qui continuent d’impacter fortement la santé bucco-dentaire. « Les enfants d’ouvriers ont plus de caries que les enfants de cadres », insiste le Dr Bazart, qui cite aussi d’autres groupes particulièrement touchés : seniors, personnes vivant avec un handicap, population carcérale, etc.
D’où l’importance de compléter les consultations de prévention individuelles chez les chirurgiens-dentistes par des mesures collectives, de santé publique, dans une perspective d’universalisme proportionné. « Il faut mettre davantage de moyens là où il n’y en a pas : par exemple, le dispositif » Aime tes dents « s’adresse en fait à ceux qui ont déjà accès à la prévention bucco-dentaire, et ne cible pas les personnes réellement éloignées du système de santé », juge le Dr Bazart.
De telles actions de santé publique devraient aller bien plus loin que la seule promotion de l’hygiène bucco-dentaire. « Tout le monde sait que manger des bonbons et des gâteaux donne des caries, mais l’accès aux produits les moins chers, très riches en hydrates carbonés, reste facilité par rapport à des aliments plus qualitatifs », regrette le Dr Bazart, selon qui un Cariscore (basé sur le modèle du Nutriscore) devrait être implémenté, et la publicité pour des produits de moindre qualité nutritive interdite à des heures de grande écoute, ou taxée au bénéfice d’actions de prévention. Mais ce genre de perspectives semblent loin. « Il n’y a pas même eu d’enquête nationale sur la santé bucco-dentaire depuis 2012 », rappelle le Dr Bazart.
Interview
« Les patients français sont assez mal informés sur la prophylaxie »
En France, la création du métier d’assistant dentaire de niveau 2 se fait encore attendre. Si la procédure semble bien engagée, le Sénat ayant adopté en février une proposition de loi clé, reste encore à définir par décret les compétences précises de ces professionnels. Quelles sont les prérogatives des hygiénistes dentaires chez nos voisins suisses ? Annouk Zollinger, hygiéniste dentaire à la clinique d’hygiène dentaire de Lausanne, décrit son parcours et son quotidien.
Quelle formation avez-vous suivie pour devenir hygiéniste dentaire ?
Annouk Zollinger : En Suisse romande, pour devenir hygiéniste dentaire, il faut suivre une formation de base d’assistante dentaire (permettant d’obtenir un certificat fédéral de capacité), puis un cursus complémentaire de trois ans dans une école spécialisée, à Genève. Ces études, à la fois théoriques et pratiques, permettent vraiment d’aller plus loin que la formation d’assistante dentaire classique sur l’hygiène, la prophylaxie, la relation avec les médecins dentistes, etc. L’école de Genève forme toutefois peu d’hygiénistes, seulement une vingtaine par an pour toute la Suisse romande. Ainsi, nous avons beaucoup de collègues belges ou canadiennes – qui ont elles aussi une très bonne formation. D’autant qu’au Canada, les hygiénistes ont le droit de réaliser davantage d’actes qu’en Suisse (comblement après traitement des caries par le dentiste, certains actes d’orthodontie, etc.).
Quels sont vos rôles au centre dentaire où vous exercez ?
À la clinique d’hygiène dentaire de Bessières, tous les patients sont d’abord vus par une hygiéniste dentaire. C’est nous qui repérons des problématiques telles que les caries, des parodontites, des troubles orthodontiques : nous proposons un dépistage complet, et orientons ensuite les patients vers les médecins dentistes omnipraticiens, les parodontistes, les orthodontistes, etc. Nous réalisons aussi des détartrages complets – après radiographie afin d’identifier la présence éventuelle de tartre sous-gingival : nous commençons avec des ultrasons, puis nous réalisons toujours une deuxième étape de curetage manuel, notamment en sous-gingival, puis un polissage, un passage de fil et une fluoration. Un autre axe important de notre quotidien concerne évidemment la prophylaxie : nous prenons le temps d’expliquer les gestes d’hygiène aux adultes comme aux enfants. D’ailleurs, je pense que le fait de recevoir des enfants très tôt pour parler d’hygiène dentaire dédramatise les consultations chez le dentiste – pas associées directement à des caries et à des piqûres. Nous pouvons aussi réaliser de petits actes d’esthétique (blanchiments instantanés au fauteuil, empreintes pour fabrication de gouttières de blanchiment, pose de strass) même si ce n’est pas le cœur de notre métier.
La répartition des tâches est-elle bien claire entre hygiénistes et médecins dentistes ?
Nous travaillons vraiment en binôme avec les médecins-dentistes. Nous nous occupons du dépistage et de la prévention – ce qui nécessite globalement des consultations d’une heure –, et cela leur libère du temps pour qu’ils puissent se consacrer au diagnostic et à des actes curatifs plus complexes (et plus onéreux). À noter que nous avons le droit d’être indépendantes, d’exercer seules dans un cabinet. Mais nous n’avons pas droit de réaliser des radiographies seules. Et je trouve que travailler seule est moins intéressant que de travailler en équipe avec des médecins-dentistes – de pouvoir discuter des cas, d’orienter les patients vers tel ou tel professionnel.
Quels conseils d’hygiène les patients peinent-ils à assimiler ?
La plus grosse erreur concerne vraiment l’oubli du nettoyage interdentaire : tout le monde a besoin de piqûres de rappel sur l’utilisation de fil ou de brossettes interdentaires. Sinon, les patients ne savent souvent pas quel dentifrice ou quelle brosse à dents utiliser : dentifrices pour dents sensibles sur des gencives qui saignent, brosses à dents trop dures qui usent les collets, etc. Nous recevons beaucoup de patients français, qui sont assez mal informés sur la prophylaxie. La plupart ne connaissent vraiment pas le nettoyage interdentaire. Ils sont souvent choqués, lors de leur première consultation avec un hygiéniste, de voir la couche de tartre qu’on découvre. Quoi qu’il en soit, les patients nous posent plus de questions qu’il y a dix ans. Des questions souvent liées à des contenus qu’ils lisent sur les réseaux sociaux (comme des conseils sur le brossage des dents au jus de citron…), qu’ils osent moins poser aux dentistes.